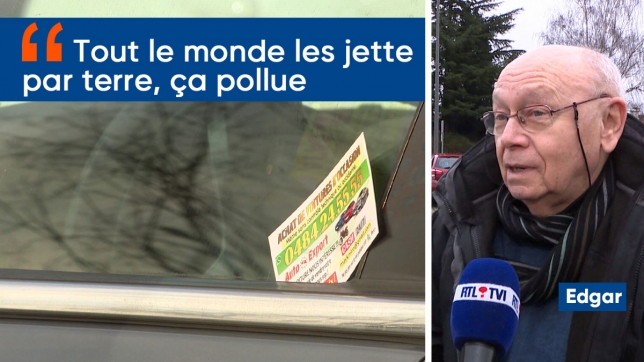Dans la lueur vacillante du cinéma Impero d'Asmara, les spectateurs suivent, emportés par l'action, les aventures héroïques de valeureux soldats érythréens se battant pour leur pays, genre de production qui prospère dans un pays marqué par son histoire guerrière.
Quatorze ans après l'indépendance de l'Erythrée arrachée de l'Ethiopie après 30 ans de guerre, la jeune industrie cinématographique du pays produit environ 60 films chaque année.
"Il y a un nouveau film qui sort presque chaque semaine", explique Franco Sardella, metteur en scène accompli qui réalisa le premier long métrage érythréen en 1997. "De plus en plus de gens apprécient ces films", note-t-il.
Son premier film, "Barud 77" - qui raconte sur un mode réaliste le combat de rebelles contre la domination étrangère - a totalisé 140.000 entrées en salle, dans un pays d'environ 4,2 millions d'habitants.
L'Erythrée a découvert le cinéma pendant la colonisation italienne et, dans les imposantes salles d'Asmara, les affiches des films italiens et américains des années 50 sont toujours exposées.
Mais c'est pendant la guerre de libération contre l'Ethiopie que les metteurs en scène érythréens ont forgé leur propre voie.
Les rebelles - aujourd'hui au pouvoir - encourageaient l'éducation artistique et enregistraient méticuleusement sur vidéo tous les aspects de la vie quotidienne au front.
Sur ces vidéos, des soldats-acteurs "jouaient pour le peuple et les combattants", explique à l'AFP Esaias Tsegay, ancien rebelle, poète et metteur en scène respecté devenu une figure de proue de l'Office culturel des combattants, après une blessure au combat. Ces documentaires de propagande visaient à encourager le peuple "à se battre pour la libération de l'Erythrée", commente-t-il.
Après l'indépendance, "nous voulions participer à la reconstruction du pays", se rappelle Franco Sardella: "la reconstruction ce n'est pas seulement rebâtir, cela concerne aussi la culture, les arts et le cinéma".
La sanglante guerre frontalière entre l'Erythrée et l'Ethiopie de 1998 à 2000 a marqué une nouvelle rupture. "Nous étions tous au front, alors il n'était pas vraiment possible de tourner", dit Efriem Kahsay, auteur de 10 longs métrages.
Dans un pays démuni, les budgets sont squelettiques. Pour une production majeure, ils ne dépassent pas les 20.000 dollars (15.000 euros).
Malgré la concurrence des films étrangers, les entrées en salle couvrent la majorité des coûts. S'y ajoutent les ventes de DVD - qui peuvent atteindre 1.000 exemplaires - aux Erythréens de la diaspora.
"Contrairement à beaucoup de films en Afrique, nos productions sont réalisées sans aucun soutien international", commente fièrement Franco Sardella, en écho à un des thèmes favoris du régime, l'auto-suffisance.
Conséquence de la maigreur des budgets, la qualité technique s'en ressent. "Nous sommes encore au début (...) mais nous apprenons et devenons plus expérimentés, dans la technique, le jeu et les scénarios", juge Esaias Tsegay.
Si l'écriture des scénarios évolue, la guerre reste un thème central. "Ma vie entière a été consacrée à la guerre - j'ai passé 14 ou 15 ans au front -, alors ce thème s'impose", dit-il.
Beaucoup de scénarios n'échappent pas aux fourches caudines d'une censure particulièrement stricte. Mais certains tentent de diversifier les sujets. "Ils font aussi des films d'amour maintenant ... Et c'est normal. S'il y a la paix, on ne s'attend pas à avoir autant de films de guerre", relève le metteur en scène.