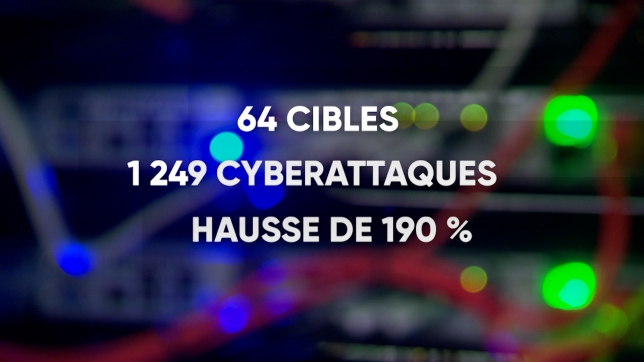Partager:
Figure du cinéma politique des années 1970, Yves Boisset s’est illustré par ses films coups de poing, souvent censurés, toujours portés par une quête de vérité.
Le réalisateur Yves Boisset est mort lundi à l’âge de 86 ans à l’hôpital franco-britannique de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, où il était soigné depuis plusieurs jours. Cinéaste engagé, il avait marqué le cinéma français des années 1970 avec une série de films politiquement puissants et souvent polémiques, comme "L'Attentat", "R.A.S" ou encore "Dupont Lajoie" devenu emblématique.
Le cinéma comme arme de dénonciation
Né à Paris le 14 mars 1939, diplômé de cinéma, Yves Boisset fait son service militaire en Algérie avant de devenir journaliste au mensuel Cinéma et assistant de réalisateurs tels que Jean-Pierre Melville ou Vittorio de Sica. Il débute derrière la caméra en 1968 avec une série B intitulée "Coplan sauve sa peau", mais c’est dès 1970 qu’il s’impose comme une figure du cinéma politique avec "Un condé" portrait sombre et critique de la police avec Michel Bouquet.
"À partir de là, les ennuis (avec la censure) ont commencé", confiera-t-il plus tard. Son œuvre suivante, "L’Attentat" (1972), revient sur l’enlèvement de l’opposant marocain Mehdi Ben Barka. Le film, avec Jean-Louis Trintignant, critique ouvertement le pouvoir gaulliste, au point que l’équipe se voit interdire de tourner sur plusieurs lieux.
Un cinéma frontal face aux tabous
En 1973, Boisset frappe à nouveau fort avec "R.A.S", l’un des premiers films français à évoquer la guerre d’Algérie. L’histoire d’appelés confrontés à l’horreur du conflit fait scandale : la censure exige la coupe de scènes de torture, des bobines sont dérobées, le financement est plusieurs fois interrompu. Malgré ces obstacles, le film rencontre un succès public.
Deux ans plus tard, en 1975, il signe "Dupont Lajoie", son œuvre la plus célèbre, inspirée de meurtres racistes survenus à Marseille. Jean Carmet y incarne un personnage ordinaire mais profondément raciste, dans un récit glaçant. Le tournage est perturbé par des menaces et agressions de l’extrême droite, des projections sont annulées. Le film devient un symbole du cinéma de combat.
Une œuvre au service de la vérité
Yves Boisset revendiquait un cinéma "contre la bêtise, dont le racisme est une variante spécifique". En 1977, "Le Juge Fayard dit le Shériff", avec Patrick Dewaere, s’inspire de l’assassinat du juge François Renaud. Le SAC (Service d’action civique, bras armé du gaullisme) parvient à faire censurer son nom, remplacé dans le film par un signal sonore. "Chaque fois que les spectateurs l’entendent, ils se mettent à crier debout 'SAC : assassin !'", se réjouissait-il plus tard. Mais le tournage lui vaut aussi une agression physique.
Il enchaîne ensuite avec des films comme "Espion, lève-toi" (avec Lino Ventura), "Canicule" (avec Lee Marvin), "Bleu comme l’enfer" (avec Lambert Wilson) ou encore "Un taxi mauve" (avec Philippe Noiret et Charlotte Rampling), l’un de ses plus grands succès publics.
De la fiction au petit écran
Fatigué de devoir sans cesse affronter la censure et les pressions, il quitte le cinéma en 1991 pour se consacrer à la télévision. Il continue toutefois à porter des récits engagés : "L’Affaire Seznec" (1993), "L’Affaire Dreyfus" (1995), "Le Pantalon" (1997), sur les fusillés pour l’exemple de 14-18, ou encore "Les Mystères sanglants de l’Ordre du Temple solaire" (2006) et "L’Affaire Salengro" (2009).
Scénariste de tous ses films, Yves Boisset a toujours revendiqué une approche engagée et sans concession du cinéma, chaque film étant pour lui "un combat". En 2011, il publie ses mémoires intitulés "La Vie est un choix", dans lesquels il accuse notamment l’ex-ministre Michel Charasse d’avoir lancé un contrôle fiscal pour bloquer un projet de film sensible sur le commerce des armes. Des accusations qui lui vaudront une condamnation pour diffamation.