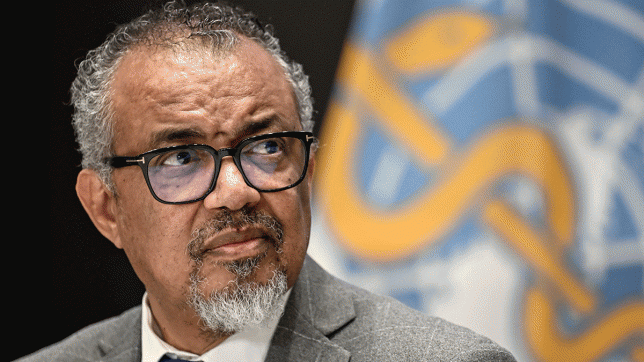Partager:
Et si la dette publique n'était pas un problème aussi grave qu'il n'y paraît ? Cette théorie, longtemps jugée hétérodoxe, gagne du terrain chez les économistes, qui relativisent l'importance des déficits dans un contexte de faibles taux d'intérêt.
C'est un débat ancien, mais qui a retrouvé de la vigueur ces dernières semaines dans les milieux universitaires et financiers, à coups d'articles scientifiques, de livres et de tribunes sur le bien-fondé des politiques de désendettement.
A l'origine de ces échanges animés: un discours de l'ancien chef économiste du Fonds monétaire international (FMI) Olivier Blanchard, tenu début janvier à l'occasion de la réunion annuelle de l'Association des économistes américains (AEA).
La dette publique, au coeur de toutes les attentions depuis la crise financière de 2008, "n'est peut-être pas si mauvaise", a avancé M. Blanchard, en invitant à revoir l'approche classique sur le sujet. "La dette peut-être utilisée, si elle l'est à bon escient", a-t-il ajouté.
En cause: la faiblesse persistante des taux d'intérêt, notamment au sein de la zone euro. Depuis l'été 2008, le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne est ainsi passé de 4,6% à 0,1%, et celui de la France de 4,8% à 0,3%. Aux Etats-Unis, le taux a reculé de 4,2% à 2,5%.
Une aubaine pour les pays concernés, qui peuvent emprunter à moindre frais et se désendetter sans avoir à produire d'efforts particuliers, le poids de la dette dans le produit intérieur brut tendant à diminuer tant que les taux d'intérêt sont inférieurs à la croissance.
Pas si grave, la dette publique ? Les propos d'Olivier Blanchard, surprenants dans la bouche d'un ex-responsable du FMI, ont suscité de nombreuses réactions - souvent favorables, parfois agacées - chez ses confrères économistes.
"La dette est un problème énormément exagéré", a jugé le prix Nobel d'économie américain Paul Krugman. "Les conclusions de Blanchard n'exonèrent pas les gouvernements de leurs responsabilités", a mis en garde de son côté Thomas Philippon, professeur à la Stern Business School.
- "Déni" ou "obsession" -
Depuis 10 ans, la dette s'est en effet considérablement alourdie dans les pays riches, passant de 71% à 103% du PIB selon le FMI. Mais la charge de la dette, c'est-à-dire le montant des intérêts remboursés chaque année, s'est allégée, passant par exemple en France de 55 à 40 milliards d'euros par an.
"Cette dimension doit être prise en compte, surtout dans la zone euro, où les taux d'intérêt sont très faibles", estime auprès de l'AFP Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, qui juge nécessaire d'avoir une approche "pragmatique" sur le sujet.
Tous les Etats, de fait, ne sont pas logés à la même enseigne: au Japon, la dette publique dépasse ainsi les 240% du PIB, sans créer d'inquiétude, ses détenteurs étant essentiellement les Japonais. En Grèce, elle avoisine les 180% du PIB et suscite la crainte des marchés.
Y a-t-il un point de bascule et comment le détecter ? Aux Etats-Unis, où la dette dépasse les 100% du PIB, le débat fait rage, notamment à travers la "théorie monétaire moderne" (TMM), en vogue auprès de certaines figures de gauche, comme la jeune élue de New York Alexandria Ocasio-Cortez.
Apparue dans les années 90, cette doctrine controversée considère que l'endettement souverain n'est pas un handicap si important, surtout dans les pays qui peuvent emprunter dans leur propre monnaie et ne sont donc jamais à court d'argent, comme le Japon et les Etats-Unis.
"Il y a très peu de circonstances" où cette politique "peut marcher", a toutefois mis en garde la semaine dernière la directrice générale du FMI Christine Lagarde, pour qui une telle politique pourrait créer "de gros problèmes" en cas de remontée des taux.
Une remontée à ce stade peu probable, mais qui provoque des sueurs froides chez certains. "Je crois que nous sommes de nouveau dans une période de déni", estime l'ancien vice-président du New York Stock Exchange, George Ugeux, dans un ouvrage prédisant un "tsunami financier" ("La descente aux enfers de la finance").
"Deni" ou "obsession" de la dette ? Entre les deux, "il y a sans doute un juste milieu", estime pour sa part Patrick Artus, économiste chez Natixis. Qui ne voit "pas de problème à court terme" mais appelle à la prudence "sur un horizon plus lointain".