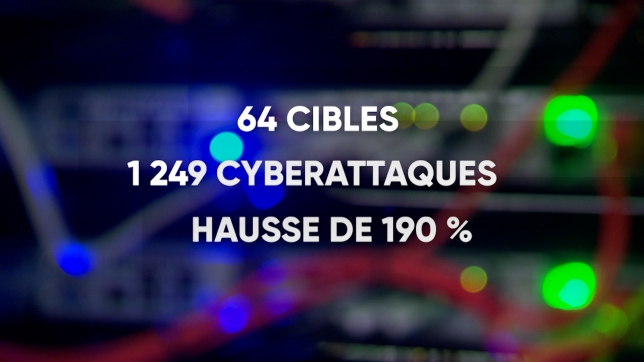Partager:
Une situation désespérée a poussé cette maman à appuyer sur le bouton orange Alertez-nous. Sa fille est atteinte de déficience mentale et est scolarisée dans une école spécialisée, à Bruxelles. Mais cette situation risque de changer du tout au tout d'ici quelques mois.
Si la scolarité des élèves dans l'enseignement traditionnel s'arrête à 18 ans ou après l'obtention du CESS, pour les personnes atteintes de handicap mental, c'est un peu différent. La scolarité est accessible jusqu'à 21 ans, âge après lequel les élèves doivent quitter leur école, généralement pour un centre adapté pour les encadrer. "Le problème, c'est qu'à partir de la rentrée prochaine, nous n'avons pas de solution pour elle. Les centres de jour sur lesquels elle est inscrite n'ont pas de disponibilité pour l'accueillir", explique la maman dont la fille a justement 21 ans. Ce que la mère de famille regrette par dessus tout, "c’est qu'à la fin de cette année scolaire, notre fille devra rester à la maison sans être sociabilisée."
Ce scénario "n'est pas une option" pour la famille. "Notre fille a le droit d'être sociabilisée. Ça lui permet d'être épanouie, de se développer". Le risque, si la jeune femme devait rester à la maison, est qu'elle régresse dans certaines de ses capacités. "Ce cas, on l'a vécu il y a quatre ans avec le Covid. On a dû garder nos enfants à la maison pendant de longs moments et donc on a constaté que des acquis qu'on avait déjà péniblement pu atteindre avec eux sont perdus ou régressaient."
Une situation inévitable pour de nombreuses familles ?
La base du problème dans cette situation, c'est la capacité d'accueil des centres spécialisés. Comme l'a souligné notre témoin, les centres n'ont pas de disponibilité. Même en s'y prenant de nombreuses années à l'avance, la situation est complètement bouchée. "Les démarches pour la transition de l'enseignement spécial vers le monde adulte commencent à l'âge de 18 ans. Quand vous contactez les centres avant 18 ans, on vous dit que c'est trop tôt et que ça ne sert à rien, même si les listes attentes sont bien remplies. Donc les démarches commencent à 18 ans et, en moyenne, on nous avait expliqué que ça ne durerait que quatre ans pour avoir une place en centre de jour. On arrive au bout de ces quatre ans et on n'a pas de place", constate la mère de famille.
"Notre fille est inscrite sur huit listes d'attente, cinq à Bruxelles et trois dans la région dans laquelle nous vivons. Tous ces centres ont des listes d'attente faramineuses. À titre d’exemple, dans un centre qui nous intéresse très fort, il y a une liste de 120 inscrits, elle est 78ᵉ alors que ça fait quatre ans qu’elle est en liste d'attente", ajoute notre alerteuse.
"On se rend bien compte que l’objectif d’avoir une place dans ce centre est encore loin pour nous", conclut-elle d'un ton désespéré.
Si on ne sait pas mesurer le besoin, on ne sait pas le chiffrer
Le manque de place est un problème bien connu en Belgique. En 2013, notre pays a d'ailleurs été condamné par le Conseil de l'Europe pour sa politique d'accueil des adultes porteurs de handicap.
Un problème dans le problème, c'est le flou qu'il y a autour du nombre exact de demandeurs de places. Les listes d'attente sont saturées, mais les mêmes personnes sont souvent inscrites sur plusieurs listes. Ainsi, une enquête de l'ULB réalisée en 2021 estime le nombre de demandeurs entre 225 et 1.413... Une fourchette énorme qui n'aide pas les autorités. "Si on ne sait pas mesurer le besoin, on ne sait pas le chiffrer", déclare Dominique Maun, chef de service de l'inspection au PHARE. Ce service de la COCOF apporte information, conseils et interventions financières aux personnes handicapées en Région bruxelloise.
Pour elle, ce manque de place est lié à plusieurs facteurs. D'abord, l'augmentation de la longévité. Comme le reste de la population, les bénéficiaires de centres d'hébergement et de centres de jour vivent plus longtemps. Leurs places se libèrent donc moins vite aussi.
Ensuite, c'est aussi lié à une évolution de la mentalité de la société. "Ça paraît évident pour tout le monde aujourd'hui qu'une personne handicapée a le droit à être autonome et qu'une famille qui a un enfant qui a un handicap a le droit à ce que celui-ci vive de manière autonome, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 30 ou 40 ans, où les mamans finissaient par rester à la maison", développe Dominique Maun. "Aujourd'hui, on n’est plus d'accord avec ça et tant mieux. C'est une bonne nouvelle pour les familles, c'est une bonne nouvelle pour les personnes handicapées et c'est une bonne nouvelle par rapport à l'humanisation de la société. Mais ça a un impact sur les demandes".
Une légère amélioration
Depuis la condamnation de 2013, en Région Bruxelloise, 86 places ont été créées en centre de jour et 87 places en centre d'hébergement.
Si la situation évolue lentement, c'est surtout pour des raisons budgétaires. Un bénéficiaire coûte 35.000 euros par an en centre de jour et 60.000 euros pour la même durée en centre d'hébergement. Des budgets qui ne tiennent pas compte des frais liés aux bâtiments et aux infrastructures.
Pour payer ces frais, le service PHARE dispose d'une enveloppe de 125 millions d'euros par an, soit 40% du budget de la COCOF. Et ce n'est pourtant pas assez pour répondre aux besoins.
Quelles solutions ?
Elles sont rares et ont davantage la forme de sursis que de vraies solutions. À Bruxelles et en Wallonie, il est possible de faire une demande de dérogation afin que l'enfant porteur de handicap puisse rester plus longtemps dans son école. La demande peut porter jusqu'à deux ans en région bruxelloise et n'est que d'un an en Wallonie. "Cela ne peut être fait que si l'école estime que c'est une bonne chose pour le bénéficiaire de poursuivre l'enseignement. Donc il y a toujours l'avis du centre PMS et l'avis également du conseil de classe. Parce que parfois, certains bénéficiaires n'ont plus envie d'aller à l'école. Donc cela, ça ne sert à rien de les maintenir dans ce cadre-là", précise Sophie Donnay, psychologue au PHARE.
En région bruxelloise, une moyenne de 25 personnes par an obtiennent cette dérogation. Malgré cela, "il n’y a pas de baguette magique pour régler la situation, même si on aimerait bien", regrette la psychologue.